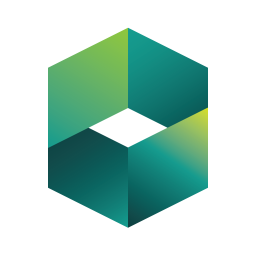La Cour d'appel de l'Ontario a certifié un recours collectif contre le fabricant d'une arme de poing volée utilisée pour perpétrer la fusillade de masse de 2018 sur l'avenue Danforth à Toronto, infirmant en partie la décision du juge des requêtes ci-dessous.
Dans l'affaire Price v Smith & Wesson Corp, 2025 ONCA 452 (Price), la Cour d'appel a autorisé les plaignants – les victimes de la fusillade et leurs familles – à poursuivre sur une base commune l'allégation selon laquelle Smith & Wesson avait conçu par négligence l'arme de poing M&P40, conçue pour un usage militaire et policier, mais utilisée à mauvais escient criminellement par l'auteur de la fusillade de l'avenue Danforth. Les demandeurs allèguent que l'arme de poing M&P40 est conçue par négligence parce qu'elle ne dispose pas d'une technologie permettant d'empêcher toute utilisation non autorisée, connue sous le nom de « pistolet intelligent » ou de technologie d'« utilisateur autorisé ».
Price clarifie le fardeau de la preuve qui incombe aux demandeurs dans les recours collectifs de conception négligente proposés pour établir la norme du « fondement de fait » à l'étape de la certification. Il s'agit également d'un développement significatif dans le droit de la responsabilité du fait des produits en général, et potentiellement dans la capacité des victimes de fusillades de masse d'utiliser le droit de la responsabilité délictuelle et la procédure de recours collectif pour demander réparation aux fabricants d'armes utilisées à mauvais escient.
Contexte
En 2020, le juge des requêtes a divisé la requête en certification dans l'affaire Price en deux phases :
- Phase 1 : Une évaluation initiale de la pertinence des réclamations des demandeurs fondée uniquement sur les actes de procédure prévus à l'alinéa 5(1)a) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;
- Phase 2 : Si les réclamations ont survécu à la phase 1, une évaluation du seuil de suffisance de ces réclamations fondée sur la preuve en vertu des sous-alinéas b) à e) de l'article 5 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.
Deux billets de blogue antérieurs décortiquent les décisions des phases 1 et 2 du juge des requêtes de la Cour supérieure :
- Phase 1 : Les fabricants d'armes à feu sont-ils responsables des fusillades de masse?
- Phase 2 : Refus de la certification dans le cadre d'un recours collectif proposé contre un fabricant d'armes à feu pour fusillade de masse
Dans sa décision de la phase 1, le juge des requêtes a conclu que les réclamations de responsabilité stricte et de nuisance publique des demandeurs étaient vouées à l'échec. Mais le juge de la requête a accepté que la demande de négligence n'était pas vouée à l'échec. À la phase 2, le juge des requêtes a ensuite refusé de certifier un recours collectif relatif à la conception négligente, concluant que les demandeurs n'avaient pas démontré « un certain fondement de fait » que les questions communes proposées pouvaient être résolues en commun dans l'ensemble du groupe et exister réellement.
Pour prouver la négligence dans la conception, ainsi que les éléments habituels de négligence, les demandeurs doivent :
- identifier un défaut de conception;
- démontrer que la défectuosité créait une forte probabilité de préjudice;
- montrent qu'il existe des moyens plus sûrs et économiquement réalisables de fabriquer le produit.
En ce qui concerne le troisième critère, le juge des requêtes a conclu que les demandeurs n'avaient démontré aucun fondement factuel en faveur d'une façon à la fois plus sûre et économiquement réalisable de fabriquer l'arme de poing M&P40.
Soulignant que les demandeurs n'avaient fourni aucune preuve d'expert sur la conception d'armes de poing, le juge des requêtes a trouvé des éléments de preuve d'un moyen technologiquement réalisable d'incorporer une technologie d'utilisateur autorisé dont Smith & Wesson avait connaissance. Mais il a constaté :
- aucune preuve d'une conception éprouvée du M&P40 intégrant une telle technologie;
- aucune preuve d'expert démontrant qu'un fabricant d'armes à feu raisonnable aurait utilisé une technologie d'utilisateur autorisée dans ses produits;
- aucune preuve d'expert indiquant que la technologie de l'utilisateur autorisé aurait rendu le M&P40 plus sûr pour les utilisateurs du produit ou le public.
Dans le dossier de la requête en certification, le juge des requêtes a donc conclu que les demandeurs n'avaient pas établi de fondement factuel pour « des choix de conception commercialement viables qui ne nuiraient pas à l'utilité ou à la sécurité du M&P40 ».
Les deux parties ont interjeté appel de différents aspects des décisions des phases 1 et 2.
LaCour d'appel réaffirme la faible pression en matière de preuve pour l'accréditation
Infirmant la décision du juge des requêtes sur ce point, la Cour d'appel a conclu qu'en reprochant aux demandeurs de ne pas avoir fourni de preuve d'expert sur les questions relevées, le juge des requêtes avait trop demandé aux demandeurs le bien-fondé de leur demande à l'étape de la certification.
La Cour d'appel a estimé qu'une preuve d'expert du type décrite par le juge des requêtes pourrait bien s'avérer importante lors d'un éventuel procès de la demande de négligence des demandeurs. Mais il existait « un certain fondement de fait » en vertu du critère de certification sans cette preuve d'expert et, par conséquent, il en était de même pour un fondement pour certifier un recours collectif.
Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d'appel a invoqué la preuve dont elle disposait au moment de la certification selon laquelle Smith & Wesson avait obtenu des brevets liés à une technologie d'utilisation autorisée et avait conclu une entente préliminaire avec le gouvernement fédéral des États-Unis en 2000 pour mettre en œuvre des fonctions d'« armes intelligentes » dans le but, entre autres, de « réduire l'utilisation abusive des armes à feu à des fins criminelles ». Smith & Wesson ne s'est finalement pas conformé à l'accord parce que le Congrès américain a adopté une loi immunisant les fabricants d'armes à feu contre la responsabilité civile envers les victimes de l'utilisation non autorisée d'armes à feu.
La Cour d'appel a réitéré que, lorsqu'il s'agit du seuil de preuve applicable, « une requête en certification n'est pas une requête en jugement sommaire ». Prouver « un certain fondement de fait » signifie fournir « un fondement probant » ou « une preuve minimale » à l'appui de la demande et de l'existence de questions communes appropriées.
Par conséquent, la Cour d'appel a conclu que les demandeurs n'avaient pas été tenus de présenter une preuve d'expert sur toutes les questions qui pourraient être soulevées au procès – ni même sur des questions qui seraient nécessaires pour prouver leur allégation de conception négligente, comme l'existence d'une conception de produit de rechange plus sûre mais économiquement réalisable. Comme l'a déclaré la Cour d'appel : « La viabilité commerciale et l'utilité ultimes d'un M&P®40 doté d'une technologie d'utilisateur autorisé peuvent être pertinentes pour un procès sur le fond, mais les demandeurs n'ont pas besoin de les établir pour franchir le seuil bas du critère des questions communes. »
La Cour d'appel a donc conclu à un certain fondement factuel de l'allégation de négligence en matière de dessin. Sur le dossier de certification, certaines preuves démontraient :
- Des mesures que Smith & Wesson aurait pu prendre, mais qu'elle n'a pas prises, pour réduire les risques d'utilisation non autorisée;
- L'entrée de Smith & Wesson dans l'accord américain confirme le fait qu'elle « croyait au moins être capable » de réduire ces risques.
La Cour d'appel a également certifié une question commune sur les dommages-intérêts punitifs, concluant que « l'engagement de Smith & Wesson à mettre en œuvre la technologie des utilisateurs autorisés » et son « recul ultérieur face à l'immunité législative » fournissaient au moins « une preuve minimale » d'« inconduite malveillante, oppressive et autoritaire ».
Nouvelle réclamation pour négligence certifiée
La Cour d'appel a conclu que les demandeurs avaient suffisamment invoqué une obligation de diligence de Smith & Wesson envers les membres du groupe. La Cour d'appel a clairement indiqué que, bien que les devoirs de diligence puissent être reconnus en fonction de catégories établies, ces catégories doivent être appliquées avec prudence et ne pas être « trop étendues ». Cette mise en garde, à la suite de l'arrêt Deloitte & Touche c. Livent Inc et Rankin c. JJ, s'appliquait non seulement aux cas de pertes économiques (comme dans l'affaire Livent), mais aussi aux cas de préjudice corporel (comme dans les affaires Rankin et Price). Au contraire, « lorsqu'une catégorie établie [de devoir] correspond parfaitement à un nouvel ensemble de faits, les tribunaux devraient entreprendre une analyse complète de l'arrêt Anns/Cooper ».
C'est ce que la Cour d'appel a fait dans l'arrêt Price. Elle a examiné si le type de préjudice allégué était raisonnablement prévisible, si Smith & Wesson entretenait une relation étroite avec les membres du groupe et si des considérations de politique générale devaient annuler toute obligation de diligence prima facie due. À titre préliminaire, la Cour d'appel a déterminé que le type de blessure allégué dans l'arrêt Price était raisonnablement prévisible « en raison de ce que font les armes à feu » (c.-à-d. « une fois entre les mains d'utilisateurs non autorisés, [les armes à feu] sont souvent utilisées pour nuire à d'autres personnes »). Elle a également conclu que, puisqu'il était raisonnablement prévisible que le M&P40 pourrait être volé, il s'ensuit « automatiquement » qu'il était raisonnablement prévisible que ces armes à feu puissent être utilisées pour blesser ou tuer des tiers parce qu'« il n'y a pas beaucoup de raisons d'avoir une arme volée que de l'utiliser pour blesser d'autres personnes ».
La Cour d'appel a conclu qu'il s'ensuivait la proximité, principalement parce que l'acte contesté – c'est-à-dire fabriquer une arme à feu sans technologie empêchant son utilisation en cas de vol – était un acte positif et non un défaut d'agir. Comme l'a déclaré la Cour d'appel, la proximité découle plus directement de la prévisibilité raisonnable lorsque la conduite est « manifeste ».
De plus, le rôle d'intermédiaire du tireur de l'avenue Danforth entre la conduite de Smith & Wesson et les blessures des membres du groupe n'empêche pas la proximité car, selon la Cour d'appel, l'acte d'intervention du tireur était « le genre même de chose susceptible de se produire » si le M&P40 n'intégrait pas la technologie de l'utilisateur autorisé.
La Cour d'appel n'a trouvé aucun motif de principe qui devrait annuler l'obligation prima facie. Elle a conclu que « [l]a catégorie envers laquelle [l]'obligation est due [c.-à-d. toute personne « blessée par une arme à feu volée"] est bien définie et sans ambiguïté ». Par conséquent, la responsabilité n'est pas indéterminée, même s'il n'est peut-être pas clair à l'avance qui éventuellement appartenir à [la] classe ».
Réaffirmant le critère en deux étapes selon le critère des questions communes, selon lequel les demandeurs doivent démontrer un certain fondement de fait à la fois que les questions communes proposées peuvent être traitées en commun dans l'ensemble du groupe et qu'elles existent réellement, la Cour d'appel a conclu à un certain fondement de fait.
En examinant la question commune proposée de savoir si Smith & Wesson avait agi par négligence en n'intégrant pas la technologie de l'utilisateur autorisé dans la conception du produit M&P40, la Cour d'appel a conclu que les demandeurs avaient démontré un certain fondement de fait selon lequel Smith & Wesson : (i) connaissait les risques liés à l'utilisation non autorisée d'armes de poing perdues ou volées; et (ii) avait mis au point des technologies réalisables sur le plan technique, sinon nécessairement économique ou pratique, pour S'attaquer à ces risques.
En examinant une autre question commune proposée sur la question de savoir si le fait de ne pas incorporer la technologie d'utilisateur autorisé a causé, contribué, nui ou augmenté le risque de préjudice pour les membres du groupe, la Cour d'appel a conclu que l'accord américain fournit un certain fondement de fait selon lequel l'incorporation d'une technologie d'utilisateur autorisé aurait empêché des utilisateurs non autorisés de manier le M&P40. En particulier, l'accord américain décrit ses objectifs, entre autres, comme étant de « réduire l'utilisation abusive des armes à feu à des fins criminelles » et de « lutter contre l'acquisition, la possession et le trafic illégaux d'armes à feu ».
À retenir
La décision de la Cour d'appel dans l'affaire Price contient des leçons et des idées pour toute personne engagée ou intéressée dans les recours collectifs proposés en responsabilité du fait des produits fondés sur des dommages corporels, ou dans la pratique et la procédure des recours collectifs pour négligence en général.
La Cour d'appel a mis en garde contre le fait que les catégories établies de devoirs de diligence ne devraient pas être étendues ou étendues de manière inappropriée. Si une catégorie établie ne convient pas à un nouvel ensemble de faits, les tribunaux devraient entreprendre l'analyse bien établie pour conclure à une nouvelle obligation de diligence.
Dans l'arrêt Price, la Cour d'appel a accepté volontiers, dans le cadre de sa nouvelle analyse de l'obligation de diligence, que la nature et le contexte des armes à feu, en tant que telles, combinés au fait que le vol d'armes à feu est raisonnablement prévisible, appuient une relation étroite entre Smith & Wesson et les membres du groupe aux fins d'une nouvelle obligation de diligence.
La conduite criminelle du tireur de l'avenue Danforth, qui a directement causé les blessures alléguées des membres du groupe, n'a pas empêché de conclure à la proximité dans les circonstances de l'arrêt Price, parce que l'utilisation abusive violente de l'arme de poing M&P40 par un criminel violent était la conséquence même de l'utilisation non autorisée du M&P40 que la Cour d'appel avait jugée raisonnablement prévisible.
En même temps, la conduite criminelle qui s'est produite a suffi à condamner les réclamations pour nuisance publique et responsabilité stricte à l'échec. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d'appel a maintenu les paramètres stricts des deux délits. En ce qui concerne la nuisance publique, la Cour d'appel a souligné que la fabrication d'armes à feu « est une activité réglementée et permise », faisant la distinction entre cette activité et « les actions de personnes qui abusent d'armes à feu ». En ce qui concerne la responsabilité stricte, la Cour d'appel a identifié des « raisons valables » de ne pas imposer la responsabilité stricte aux fabricants. Elle a conclu qu'il serait inapproprié d'étendre la responsabilité stricte à Smith & Wesson, « en particulier lorsque les dommages ont été causés par un tiers lors de la perpétration d'un crime ». Elle a fait remarquer que les fabricants « ne peuvent pas garantir que tous les articles sont incapables de nuire aux personnes, en particulier lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions », et « n'assurent pas une personne qui subit des blessures en utilisant [leurs produits] ».
En ce qui concerne la preuve requise à l'étape de la certification, Price souligne que, bien que les demandeurs doivent fournir un certain fondement de fait sur l'existence des questions communes proposées (et non seulement qu'elles peuvent être tranchées à l'échelle du groupe), le fardeau de la preuve demeure faible. Les demandeurs n'ont pas besoin de présenter une preuve d'expert sur toutes les questions qui peuvent se poser au procès. Selon le cas, il se peut qu'ils n'aient pas besoin de preuves sur certaines questions, même si ces preuves seront nécessaires pour prouver leur affirmation sur le fond.
Price souligne le niveau élevé auquel les tribunaux aborderont les réclamations lors de la certification et ce qui peut justifier l'exigence d'une « preuve minimale » de négligence dans la conception. Dans les cas appropriés, le jugement sommaire peut être intenté en même temps que la certification, comme dans Dussiaume v Sandoz Canada Inc, 2023 BCSC 795, dans lequel Bennett Jones a demandé avec succès un jugement sommaire pour son client, la défenderesse Pharmascience Inc. Mais Price réaffirme qu'« une requête en certification n'est pas une requête en jugement sommaire ».
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette affaire, ou sur les recours collectifs en général, veuillez communiquer avec un membre du groupe Bennett Jones Groupe de litiges
collectifs.